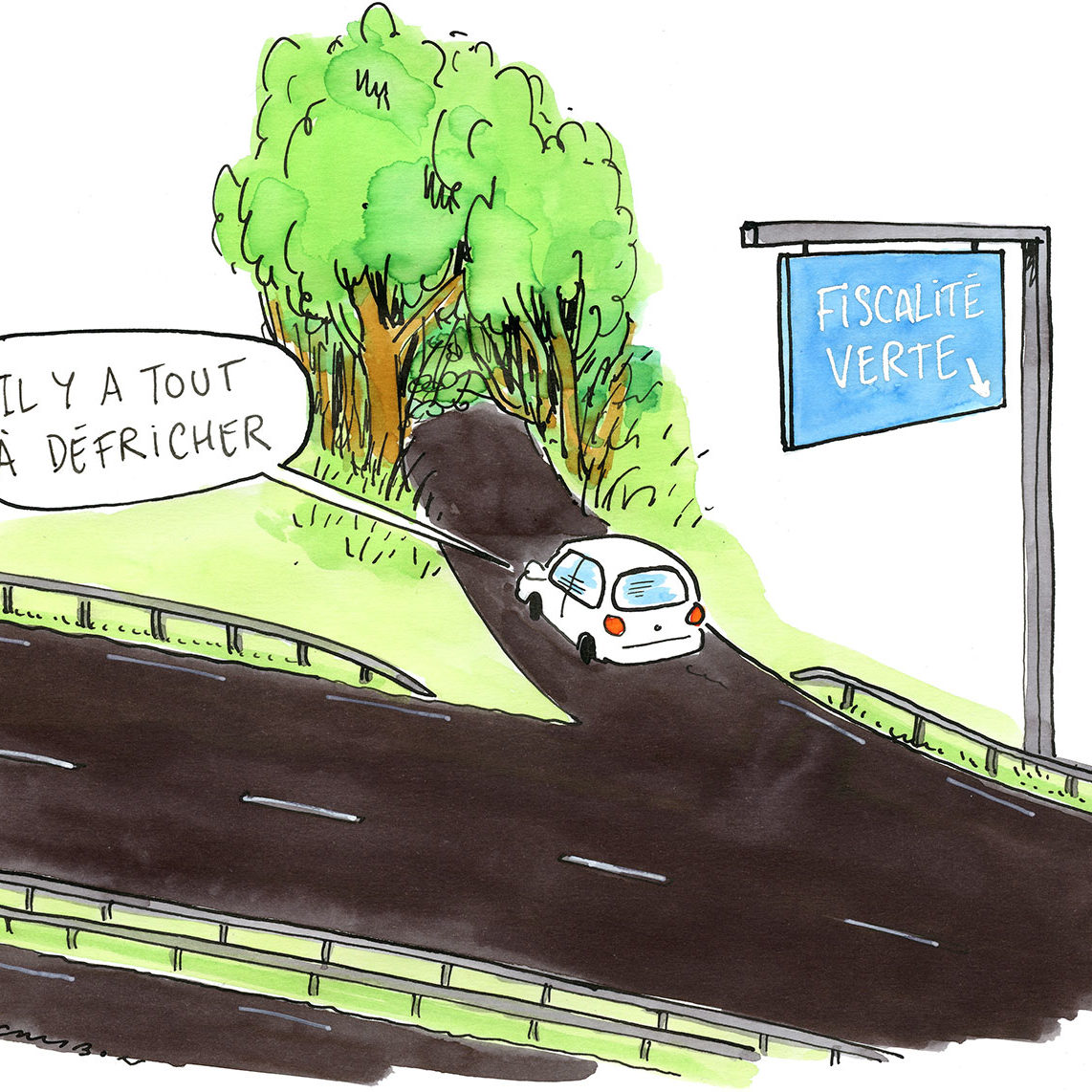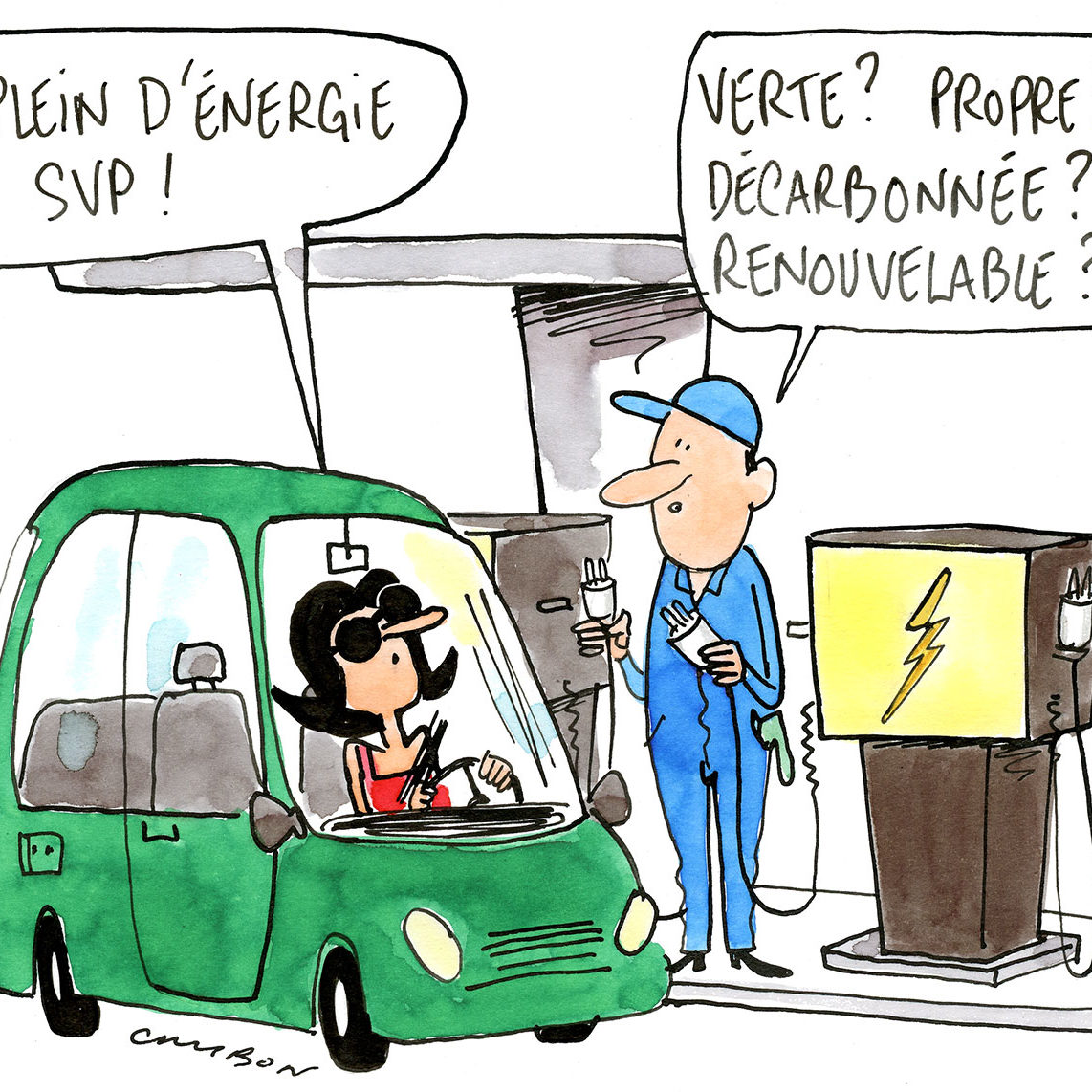Les appels à la transformation du management et des entreprises se succèdent depuis que le numérique est devenu le nouveau paradigme de croissance.
En effet, la montée en puissance du numérique et ses conséquences (automatisation, dématérialisation, désintermédiation/ré-intermédiation) réinterrogent les fondements mêmes de l’entreprise et les relations de celle-ci-avec son écosystème ; désormais, l’innovation n’est plus essentiellement tirée par les grandes entreprises ou les grandes organisations mais aussi par les utilisateurs, les clients, les partenaires et même par l’écosystème au sens large.
Pour éviter que ces appels ne restent un vœu pieu, de l’humanisme verbal qui réchauffe les cœurs sans aucun impact sur la réalité du vécu des salariés, essayons ensemble de déterminer les conditions de possibilité d’un management reformé.
Passer de la main d’œuvre au cerveau d’œuvre n’est pas suffisant
Avec le numérique, le cerveau d’œuvre devient l’instrument de gestion, l’injonction permanente à l’initiative devient la norme. La valeur ajoutée de l’organisation ne se limite plus à sa capacité d’exécution mais à sa capacité à assurer une émulation féconde capable de générer des innovations incrémentales et/ou de rupture, de processus et/ou de produits.
Que le paradigme de croissance soit basé sur la main d’œuvre ou sur le cerveau d’œuvre, le travail reste un bien fictif comme la terre ou la monnaie (Karl Polanyi). Dans une situation de travail, ce n’est pas seulement sa force de travail (main d’œuvre) ou sa force de création (cerveau d’œuvre) que nous engageons. C’est son être en entier, son essence d’homme que nous mettons à profit.
Engager son être nécessite comme contrepartie un véritable « commerce de la considération » (Michel Volle) qui passe par ce que j’appelle le cœur d’œuvre : c’est-à-dire la « gestion d’une coopération conflictuelle » au sens de Michel Crozier et de Erhard Friedberg. Dans cette optique, le management doit être l’instrument capable de faire converger les sens singuliers des travailleurs avec les aspirations de l’entreprise.
Un nouveau compromis « fordiste » du 21e siècle passera par la liberté non pas au travail mais dans le travail
Henry Ford a très vite compris l’intérêt de proposer des mesures d’accompagnement aux salariés. Il s’agissait de leur faire accepter l’organisation scientifique du travail et ses inconvénients en leur proposant un certain nombre d’incitations qui passaient notamment par le partage de la valeur. C’est ce qu’on a appelé le compromis fordiste. Dès lors, penser le travail pouvait se faire sans penser l’homme au travail.
Plus tard, l’assurance chômage et des garanties spécifiques venaient couronner cette émancipation du travail au grand dam du travailleur, renvoyé à panser ses plaies hors du travail. L’essoufflement du compromis a entrainé la résurgence du mythe d’un management humain sans questionner le travail en tant que tel.
Le numérique a le mérite de réintroduire le travail en même temps que le travailleur dans l’équation de la valeur au-delà de tout artefact devant rendre le travail supportable. Penser l’homme au travail, comme le note Yves Schwartz, c’est « se demander comment se nouent le corps, le psychisme et les normes, comment s’articulent le privé et le public, le calcul marchand et les valeurs qui n’ont pas d’étalon de mesure, l’industrieux, l’éthique et le politique ; c’est rencontrer les processus dynamiques qui immergent le langagier dans l’activité et requestionnent les théories du langage, les rapports du microscopique et du macroscopique, du local et du global… ». Penser le travail, c’est donc d’abord penser l’homme au travail dans toute sa complexité, complexité occultée par diverses théories du management fondées essentiellement sur la rationalité instrumentale.
Il n’y a pas de création individuelle de richesse mais il n’y a pas non plus d’esprit critique collectif
Avec une course technologique qui n’est plus essentiellement tirée par les grandes entreprises ou les grandes organisations mais par des individus qui peuvent tous être porteurs d’innovation, l’intelligence collective doit supplanter la légitimité du grade. En effet, jusque-là, celui qui décide, c’est le chef, qu’importe sa légitimité réelle, du moment où il a le grade. L’entreprise fait donc revivre maladroitement la hiérarchie platonicienne avec le risque que ceux qui sont en haut de l’échelle n’aient ni le supplément d’âme nécessaire ni la connaissance du terrain : trop souvent, ceux qui sont au sommet ne se rendent pas compte de la réalité et ceux qui sont en bas de l’échelle n’ont pas la légitimité pour décider.
Pour réconcilier le sommet et la base et capter la « valeur » portée par tout collaborateur, la promotion de l’intelligence collective est fondamentale. Nous pouvons définir l’intelligence collective comme la capacité collective à engendrer des capacités (capacité de réflexion, de compréhension, d’action et d’amélioration continue).
Cette capacité collective ne doit pas aller à l’encontre des capacités individuelles, terreaux de l’esprit critique qui ne peut qu’être individuel. Il faut donc instaurer un dialogue permanent entre les capacités individuelles et l’intelligence collective. Une intelligence collective non bornée par l’esprit critique peut mener à des absurdités collectives. De même, l’utilisation raisonnable de la raison est toujours de mise pour pallier une pensée hors sol. Pour agir intelligemment, l’intelligence ne suffit pas, disait Tchekov.
Penser le management non plus comme autorité mais comme responsabilité
Penser l’homme au travail, refonder un « compromis fordiste » au 21e siècle d’autorité, sauvegarder l’esprit critique tout en promouvant l’intelligence collective nécessitent une vraie refondation de l’entreprise et du management. Le management par autorité doit laisser place au management ergologique, c’est-à-dire un management qui prend en compte la perception et le vécu de l’homme au travail, ses paradoxes et ses conflits internes créateurs de consensus et de bifurcations, d’inattendues et de sérendipité.
Cela nécessite de passer d’un positionnement managérial de puissance à l’intériorisation des limites c’est-à-dire à la responsabilisation ; Montesquieu, ne disait-il pas la même chose par cette phrase : « La vertu même a besoin de limites ».
Le travail a certes besoin de mesures exogènes d’accompagnement (assurance chômage, primes etc…) mais il a surtout besoin de mesures endogènes permettant à l’homme au travail d’exprimer pleinement sa capacité de création. Ces mesures endogènes passent nécessairement par l’instauration de limites. La où il n’y a pas de limites, il n’y a pas de sens.
Ce mouvement de la force à la limite n’est pas juste un repositionnement managérial fruit d’un opportunisme méthodologique, c’est un choix radical de reconfiguration de l’épistémè de l’entreprise. C’est un choix fondamental de gestion. Comme tout choix, ce dernier a un prix et c’est le prix de l’éthique de la non puissance, concept théorisé par Jacques Ellul.
Pratiquer une éthique de la non puissance n’est pas constater son impuissance (ne pas être capable de) mais un renoncement partiel ou refus de la puissance (« on a les capacités mais on décide de ne pas faire ») pour des raisons qui peuvent être éthiques, politiques, écologiques, de justice sociale ou simplement liées à la difficulté d’appréhender à court terme les conséquences de ses choix. Une telle sagesse pratique (phronesis) elle est-elle soluble dans le « je managérial » ? En tout état de cause, il y a un prix à payer.
Ibrahima FALL, Directeur chez Eurogroup Consulting & Docteur en management